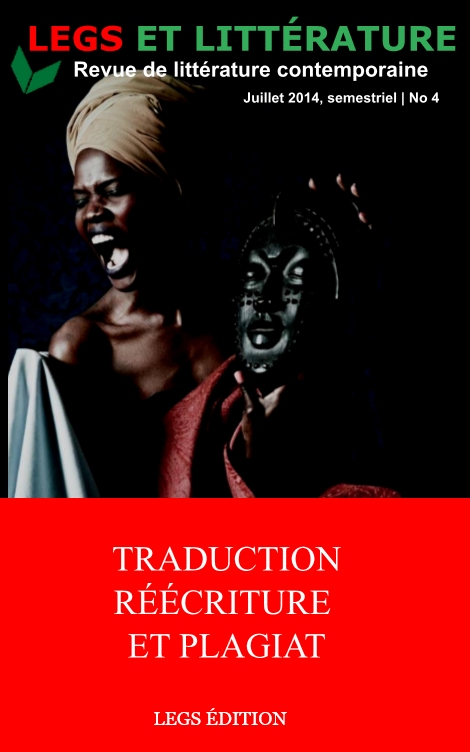Le grand effarement

J’ai commencé à lire Guy Régis Jr. presque comme tous ses lecteurs, par un livre titré « Ida, Monologue déchet ». Mais, vous dis-je, de mémoire d’homme, jamais sous-titre ne seyait aussi bien à une œuvre. Ce qui m’a un peu empêché de lire ses autres pièces de théâtre. Mais j’ai été particulièrement attiré par le titre « De toute la terre le grand effarement » lors d’un travail avec d’autres collègues critiques pour une communication à Mount Holyoke College autour des « écritures du séisme ».
Les morts sont des étoiles filantes
« De toute la terre le grand effarement » met en scène deux putains anonymes, après l’effondrement du bordel « Bèl Amou » au soir même du mardi 12 janvier 2010. La jeune et la plus âgée sont les seules rescapées de l’écroulement du bordel. Perchées sur un arbre, elles comptent absurdement les étoiles filantes. Ce qui peut, bien sûr, paraître banal. Mais au-delà de la simple idée d’étoiles filantes, la pièce revêt une valeur symbolique. Comme on le sait, au théâtre, rien n’est ornement. Le nombre d’étoiles filantes correspondrait au nombre exact de personnes mortes sous les décombres. À défaut de statistiques officielles convaincantes, car toutes contradictoires, deux putes se proposent de compter les cadavres, en partant des fulgurances, des éteignements… : « Regarde. Regarde. Occupe-toi à compter s’il te plaît. Oublie. Occupe ton esprit. Occupe-toi. Compte s’il te plaît ». (p. 40) Mais que comptent réellement ces deux putains ? N’est-ce pas également le nombre incessant de personnes qui fuient le pays ? : « De ceux qui partent, laissent le pays, nous laissent dans nos misères. On parlait de ceux qui nous laissent » (p. 22) ?
C’est aussi le nombre d’avions transportant l’aide internationale volant au-dessus de nos têtes, le soir même du séisme pendant que la communauté internationale se déchirait pour le contrôle du territoire.
« Et ceux qui arrivent, viennent par milliers. Tous ces milliers de coalitions, de pays. Ils sont organisés, sont partout. Tous ceux-là, ces étrangers. Nation contre nation pour nous envahir, s’installer, prendre place, rester. Malgré notre affaissement. » (p. 18)
Mais qu’il s’agisse de morts, d’émigrés ou de la communauté internationale, le nombre d’étoiles filantes est « infini ». Les personnages le disent eux-mêmes : « C’est insensé de compter tout ça. Cela prendra trop de temps. Oui, insensé de compter toutes ces fulgurances, ces éteignements. Tous ces passages, ces effilements, on n’en finira pas. » (p. 16)
Toute la pièce semble être un chant funèbre où le jeu (le décompte des étoiles filantes) serait le refrain qui revient incessamment pour finir par un chant prosaïque, dont les courtes phrases laissent l’impression au lecteur qu’il s’agit de paroles à dire, à scander, plutôt qu’à chanter mélodieusement.
Érotisme et tabou
Les deux putains se touchent dans le noir, sensuellement. Ce jeu commence par l’invitation de la jeune à la plus âgée à toucher son corps. La scène se déroule progressivement, passant d’un érotisme voilé à une pornographie assumée. « Laisse ta main. Continue. N’abandonne pas. Touche. Vas-y », réclame fébrilement la jeune jusqu’à ce que ce jeu les amène à une scène où chacun sodomise l’autre avec un gode-ceinture à tour de rôle. Si cette scène, racontée avec cruauté, peut paraître vulgaire, il ne faut pourtant pas se laisser aller à une lecture au premier degré. Avant la scène, la plus jeune et la plus âgée enfilent respectivement des uniformes des armées américaine et française. De telle sorte que cette scène de soumission « partagée » ou de guerre caractériserait la lutte des puissances américaine et française pour le contrôle du territoire.
Publié à Paris en mai 2011 par les éditions « Les Solitaires Intempestifs », « De toute la terre le grand effarement » a été joué au Festival d’Avignon la même année.
Wébert Charles